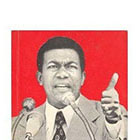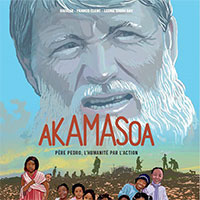Bemiray – « Pour que la mer ne soit plus la limite de notre rizière »

23/01/2016 | 2933 |
Commentaires Facebook
Tom Andriamanoro revient sur les trois grands rendez-vous internationaux que Madagascar, une île magnifique, selon Antoine, accueille cette année, s’étendant notamment sur le Sommet de la Francophonie. Il publie aussi sa série d’articles sur Air Madagascar, cette fois-ci, à la belle époque de Maurice Rajaofetra, pour finir avec un autre moyen de transport bien malgache, le boutre.
Réunions internationales – Consommées sans modération
2016, l’année de la démesure ! Un pays pour qui l’organisation d’une édition des Jeux des Iles n’est déjà pas une mince affaire, décide d’inscrire d’un coup trois rendez-vous majeurs sur son agenda. Les prévisions parlent d’elles-mêmes : 500 participants attendus pour la réunion des parlementaires francophones de juillet, un millier pour celle de la pourtant bien discrète Comesa prévue en octobre, et 3 000 pour l’évènement de l’année que sera la grand’messe de la Francophonie, en novembre. Le terrorisme international faisant chaque jour un peu plus ses preuves en se riant des frontières, il est également question, pour ce Sommet, de mobiliser une véritable armada sécuritaire, en partie venue de l’étranger. Seront donc présents, les pays où le français est la langue maternelle, les créolophones où il est langue seconde, les anciennes colonies où il bénéficie du statut de langue officielle, et les pays où il est une langue étrangère à part entière, mais privilégiée. Quant au pays hôte, il est l’un de ceux où l’enseignement et la pratique du français partent en miettes. Un vrai paradoxe…
Il va de soi que le rendez-vous de la Francophonie éclipse déjà dans les esprits les deux autres. Ne le présente-t-on pas comme une occasion exceptionnelle pour les opérateurs de conclure entre eux des joint ventures, un terme qui supplante de plus en plus son équivalent français Les puristes crieront à un détournement d’objet quelque part, car si les pionniers ont défini le concept de « francophonie » sur la base du « partage de la langue française, pour l’épanouissement et l’enrichissement de tous les pays qui la composent », ce n’était pas tout à fait dans ce sens-là. Ils avaient même placé les hommes de culture, et non les hommes d’affaires, au premier rang des artisans de cette vaste communauté. La « langue de chez nous » que chantait Yves Duteil n’est déjà plus qu’un prétexte. Quant au nom du géographe Onésime Reclus qui a forgé ce mot bizarre de « francophonie » en 1880, alors que Madagascar était encore sous le règne de Ranavalona II, il ne doit strictement rien dire aux nouveaux amis de la « francobizz » nouvelle version.
Pour le succès de cet évènementiel de novembre, il s’est formé un regroupement de sociétés à majorité française implantées à Madagascar, sous l’appellation de « Les amis de la Francophonie ». En France, lors de la dernière Cop21, une bonne cinquantaine de mécènes ont, eux aussi, donné le ton, en s’érigeant en « Partenaires officiels Paris 2015 », et en déboursant des millions d’euros pour le succès de cette réunion à dimension planétaire. Initiative louable en soi, le prestige de la France et de son industrie étant en jeu, sauf que beaucoup d’entre eux ne sont guère des modèles en matière de protection de l’environnement. On pourrait citer Bolloré qui possède d’importantes parts dans le capital d’une société exploitant plus de 180 000 hectares d’hévéas et de palmiers à huile dans une dizaine de pays. Ces espèces sont responsables de la disparition en 2014 de près de 10 millions d’hectares de forêts tropicales. Michelin importe annuellement 800 000 tonnes de caoutchouc naturel, dont il est difficile de certifier qu’elles ne proviennent pas de déforestations. Les émissions d’oxyde d’azote de certains véhicules diesel comme l’Espace Energy dci 160 de Renault peuvent, en conditions réelles, dépasser de quatre à huit fois les normes. Engie, Suez Environnement, ou encore Air Liquide étaient aussi parraineurs de la Cop21, alors que parmi leurs matières premières figure le gaz de schiste non renouvelable et fortement émetteur de gaz à effet de serre. EDF, pour sa part, est un magnat du charbon avec ses quinze centrales qui rejettent annuellement quelque 70 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Leurs homologues qui se mobilisent à Madagascar autour du Sommet de la Francophonie, ont, elles aussi, pour motivations premières leurs propres affaires, d’autant plus que le pays est plutôt mal en point, et que les autorités ont besoin d’un sérieux coup de main. À d’autres donc les grands idéaux. Silence, on investit.
Concernant la partie malgache, et mises à part les questions d’infrastructures qui accusent un retard inquiétant, une des principales interrogations est de savoir comment réussir à changer le visage d’une capitale-hôte où la pauvreté et ses corollaires se sont profondément incrustés. Autrefois, les pays communistes, avides eux aussi de réunions de prestige, étaient passés maîtres dans l’art d’imposer des circuits de visite préprogrammés, d’ériger des panneaux géants pour cacher ce qui a lieu de l’être, ou de rafler les miséreux dans les rues. Pareils artifices ont fait leur temps et ne trompent plus personne, surtout pas la presse internationale. Pris au piège de ses propres envies de paraître à défaut d’être, le régime parviendra-t-il à résoudre, ou du moins à atténuer en 10 mois ce qui n’a jamais été sa priorité pendant deux ans ? Mariera-t-on de force la rigueur du « vita vazaha » au génie de « l’ady gasy » ? Novembre c’est demain, le dernier mot est à une OIF soucieuse de son image.
Mer – Boutres et goélettes
Les boutres font surtout du cabotage autour de l’île pour collecter les produits et approvisionner les zones enclavées.
Les boutres font surtout du cabotage autourde l’île pour collecter les produits et approvisionner les zones enclavées.
Morondava. Spectacle insolite que celui, à marée basse, de ces boutres amarrés à un piquet, qui se couchent lentement sur le flanc comme pour une sieste bien méritée. Pour peu on s’attendrait à les entendre ronronner… Tout autre est la description faite par le Guide Carambole de l’animation soudaine, malgré la chaleur, du port aux boutres de Mahajanga lors du passage de ces pittoresques embarcations : « Noix de coco en tas, bottes de raphia d’Analalava, bois de la Mahajamba, encombrent le quai. Les transbordements se font à dos d’homme, et une armée de dockers effectue un va-et-vient incessant entre les cales des navires et les dépôts. Les imposantes goélettes de construction artisanale laissent entrevoir leurs poulies de renvoi, leurs cordages en fibres naturelles, et leurs voiles souvent rapiécées et usées par le soleil et les coups de tabac dus au Varatraza. Le cuistot prépare le repas de l’équipage au charbon de bois dans une petite cabane aménagée. »
A la différence du boutre d’origine indo-arabe – comme quoi la Mer Rouge de Monfreid n’est pas si loin ! -, la goélette possède une histoire assez peu connue qui peut pourtant la placer au rang de véritable patrimoine. En 1861, en effet, le roi Radama II, soucieux de tirer le meilleur parti de la mer entourant le pays, sollicite de Napoléon III l’envoi de charpentiers de marine. C’est la toute première véritable mission de coopération technique conclue d’État à État entre la France et Madagascar, et elle est confiée à un Breton du nom de Joachim et à ses trois fils. Les quatre hommes s’installent à Belo-sur-mer, confortablement, pouvons-nous le supposer, puisqu’ils n’auront plus jamais l’idée de retourner dans leur pays. Les Vezo, habiles constructeurs de pirogues, prêtent une oreille attentive à leur enseignement, et deviennent de véritables maîtres charpentiers, à même de transmettre à leur tour un savoir empirique. En 1913, une école de charpenterie navale est ouverte à Morondava, portant tout naturellement le nom de Joachim.
2001. Une organisation non gouvernementale française de la région de l’estuaire de la Loire, du nom de Transmad, s’engage dans un programme d’appui aux activités de construction de goélettes, en collaboration avec plusieurs organismes dont le WWF et l’ancienne ANGAP. L’objectif est de moderniser la filière afin de valoriser la gestion des ressources naturelles des forêts. En juillet 2006, les côtes bretonnes voient l’arrivée en France d’une authentique goélette construite à Morondava, selon les techniques de Joachim, et aménagée à Toliara. Le « Lovasoa », c’est son nom, a un programme bien chargé, centré sur la promotion du label « vita malagasy », allant de l’art culinaire à la culture vezo. Après une participation en invité vedette au Festival des rendez-vous de l’Erdre, à Nantes, le « Lovasoa » est de nouveau présent à cette grande fête de la mer et des marins qu’est le « Brest 2008 », où un village malgache de 1000 m² est reconstitué. Bon vent à nos goélettes !
Transport aérien – On m’appelait le Voron-tsara dia
Deuxième partie : Malgachisation et coopération Sud-Sud
L’itinéraire du tout premier directeur général malgache appelé à succéder au Français Jacques Alexandre, l’a bien préparé à ses futures responsabilités.
Ingénieur sortant de l’École nationale de l’Aviation civile (ENAC) de Toulouse, Maurice Rajaofetra décide de compléter sa formation par une filière généraliste, et choisit l’École centrale des Arts et manufactures de Paris, où il voit passer la tempête de mai 68. Admis au sein de la Direction du matériel d’Air France, il est affecté au Département entretien de l’Aéropostale de nuit basé à Orly-Sud. Il travaille alors pendant la journée avec les équipes de mécaniciens, et vole une partie de la nuit en tant que copilote. Son « escale » suivante est le Centre de révision, où il est associé à la préparation des grandes visites des Boeing 707 et 727.
Son recrutement définitif par Air Madagascar date de mai 1971. Alors qu’il est à la Division révision des équipements, il négocie avec Ethiopian Airlines un accord Sud-Sud modèle portant sur la formation de techniciens malgaches, en échange de la révision de matériels aéronautiques. À qualité égale, les conditions sont plus intéressantes que celles offertes par le Centre de Vilgénis en France. Il pense déjà très sérieusement à la possibilité de transférer l’entretien du Boeing 737 de Johannesburg à Antananarivo, et parvient petit à petit à convaincre ses supérieurs. En plein dans la tourmente de l’après-mai 72, Maurice Rajaofetra résiste aux pressions qui veulent faire de lui, tout de suite, le directeur général. Daniel Andriantsitohaina, le président du Conseil d’administration, comprend sa prudence. Il n’accède au poste qu’en 1974, à l’âge de 34 ans.
Air Madagascar se fixe quatre objectifs principaux : le développement des réseaux, l’optimisation des moyens de production, l’ambition de devenir le premier transporteur aérien de la région, et la malgachisation complète du personnel. Avec Air Mauritius, la Linea Aera de Mozambica, Air France et la South African Airlines, elle parvient à faire accepter l’utilisation de son B.737 pour le compte des cinq compagnies sur leur réseau inter-pays, mais en changeant de numéro de vol entre chaque tronçon. C’est une grande première pour l’époque, et le coût moyen de production s’en trouve ramené au minimum.
En avril 1977, le dossier de présentation du nouveau Boeing 747 est porté en conseil des ministres. Pour parvenir à un total de 5 000 heures de vol annuelles et un coefficient de remplissage satisfaisant, un accord est trouvé avec Air France qui s’engage à hauteur de 3 000 heures. La livraison a lieu en février 1979. Air Madagascar a désormais la flotte la plus moderne de la zone.
En 1982, le polytechnicien Nirina Andriamanerasoa succède à Dahy Adrien à la présidence du conseil d’administration. Un processus de dé-filialisation est enclenché en 1985, permettant à Air Madagascar de se désengager des filiales créées en amont et en aval du transport aérien, pour l’accompagner et combler certains vides. Il s’agit de Madagascar Airtours, Air Route Service, Zahamotel, et la Somhi qui s’occupait principalement de la construction de l’Holiday Inn d’Andilana. Antananarivo accueille la réunion annuelle de l’Association des transporteurs aériens francophones (ATAF) en janvier 1986. Les objectifs qui lui ont été assignés en 1974 ayant été atteints, il est temps pour Maurice Rajaofetra de tirer sa révérence…
Aujourd’hui encore, les nostalgiques se souviennent qu’Air Madagascar a assisté Air Mauritius à ses débuts en lui fournissant mécaniciens et pilotes, et en la conseillant dans la mise sur pied de son réseau Twin Otter. Véritable leader dans cette partie de l’océan Indien, elle a fait de même avec les Tanzaniens au lendemain de l’éclatement d’East African Airways. Les opportunités d’une coopération franche et fructueuse étaient réelles entre pays du Sud qui avaient besoin de compagnies saines et dynamiques. Le « Voron-tsara dia », l’oiseau au bon vol, en était une.
(À suivre)
Air Madagascar s’est fixé quatre objectifs dont l’ambition de devenir le premier transporteur aérien de la région n’est pas le moindre.
Air Madagascar s’est fixé quatre objectifs dont l’ambition de devenir le premier transporteur aérien de la région n’est pas le moindre.
Rétro pêle-mêle
Parole d’Antoine !
Le dernier passage du navigateur solitaire, également réalisateur de la série télévisée « Ile était une fois », et meilleur ennemi de Johnny Halliday du temps du yé yé et des chemises à fleurs, remonte à 2003. Ce fut pour nous l’occasion de parler à bâtons rompus de « notre » pays natal. Car on l’a assez dit, Antoine est né à Toamasina.
Le tourisme malgache : A Madagascar, il y a des dizaines de destinations aussi belles les unes que les autres. Et il n’y a pas à craindre de surpopulation touristique puisque l’île est immense. Mais il faut être attentif, régir les choses sans les interdire. Il faut aussi aider les professionnels. Tous ceux que j’ai vus, Malgaches comme étrangers, sont amoureux de ce pays. Si c’était tout simplement pour faire fortune, ils se seraient implantés dans des destinations moins compliquées.
Madagascar et la concurrence : Je connais beaucoup de pays qui ont des sites merveilleux. Mais entre deux endroits, ça n’a aucun intérêt, ça peut même être très laid. Et puis il y a des pays où c’est beau tout le long des itinéraires. Je citerais le Vietnam et Madagascar. De Tana à Tuléar, par exemple, chaque kilomètre est beau, on n’arrête pas de s’arrêter pour filmer !
Le projet minier de Fort-Dauphin : Il faut être réaliste, il n’y a pas que le tourisme, il y a autre chose qui doit être mis en valeur à Madagascar. L’important est que tout cela s’harmonise sur fond de respect des gens et des lieux. Comme je sais les Canadiens très près de la nature, je suis confiant que le projet n’abimera pas cette région magnifique.
365 jours dans la vie d’Antoine : D’abord, les périodes de navigation en bateau. Je navigue généralement seul. Ensuite, un petit moment en famille à Tahiti, mais je suis plutôt un grand solitaire. Pour les tournages, on se lève à 6 heures du matin et on crapahute jusqu’au soir, crevés mais heureux. Paris, enfin, pour le côté administratif et technique du travail, sans oublier les télés pour la promotion. Une vie finalement passionnante à chaque seconde.
Source: Tom Andriamanoro - lexpressmada.com

.png)